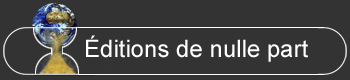Je suis en Arthey où rêvent les chevaux.
La peau noire de la nuit nappe les frondaisons, se froisse sous la pluie. Les nuages ont mangé les croissants de la lune. Le château est désert où dorment les amants. Les fenêtres occultées sont autant de paupières. Les chiens se sont couchés, bardés de muselières. Et les chats dans les branches dardent leurs yeux d’or pers.
Je suis en Arthey où rêvent les chevaux secouant leurs crinières. Je suis dans la clairière où pourrissent les feuilles et fouillent les carabes, bousiers et scolopendres. Je suis dans la tourbière où s’enlisent les mousses et les sphaignes. Je longe la rivière où sifflent les crapauds, en attente de métamorphoses princières. J’arrive à la cascade où se noient les roseaux. Ophélie flotte entre deux eaux. J’habille les futaies d’écharpes de brume et de costumes d’amertume (tuniques tissées d’orties rêches et de lierre constricteur). L’ombre du renard me frôle et sa fourrure est fraîche. La fouine couine, je l’entends qui trottine sur mes traces. Le château est désert où tremblent les amants. C’est l’heure où le grand-duc règne en propriétaire. Et le chat de Chester cligne des dents. C’est l’heure où s’éveillent les oreillards et dansent les pipistrelles. Chuchotement vorace d’ailes veloutées.
Je suis en Arthey où bronchent les chevaux dans leur sommeil inquiet. Le parc est solitaire où se fanent les roses. L’herbe est rase aux pelouses mouillées. Je convoque les quatre vents : les girouettes s’affolent et les contrevents battent. Le château est désert où chuintent les charnières et grincent les planchers. Les tentures se gonflent et les miroirs se brisent. Le château est désert où hurlent les amants. Je suis ici chez moi et je hante les lieux. Est-ce pour cette nuit ? Allumerai-je un feu ?
Je suis en Arthey où gémissent les fantômes.