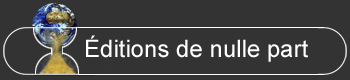Tu dors et les traits de ton visage sont lisses.
Tu dors paisiblement, les traits lisses, la respiration régulière et profonde.
Tu dors allongée sur le dos dans un lit propre aux draps si peu froissés.
Le jour inonde la chambre blanche et peu meublée;
meublée de lumière, la lumière qui ne traverse pas tes paupières.
Tu dors, allongée sur le lit au milieu de la chambre immaculée, absente encore à tout ce qui t’entoure.
Tu dors et sans doute, derrière les traits paisibles de ton visage immobile, derrière tes mains posées sur le couvre-lit,
derrière le souffle de ta respiration,
là dans la chambre blanche baignée de lumière,
perçois-tu l’écho des pas des passants sur les trottoirs souillés,
des cris des voitures sur les rocades affolées,
du grondement des métros dans les tunnels obscurs;
l’écho de la vie lointaine et soudain si proche.
L’écho à peine deviné à travers la vitre de la chambre blanche,
à peine chuchotée, la vie de la ville.
La vie si infime par delà la fenêtre, par delà tes paupières closes.
Dans ton sommeil lourd, le poids de ta poitrine qui se gonfle et s’affaisse ne t’atteint même pas.
Tu reposes tes heures chahutées, ces temps éreintés et tes courses folles.
Tu cours, tu cours, derrière les paupières de ton visage lisse.
Tu cours et tu voudrais te reposer encore un peu.
Mais tu cours, couchée sur le lit blanc, les traits imperturbables, reliée à la vie par ce tube qui te la souffle.
Tu cours, tu cours et tu attends qu’un jour on te le coupe ce souffle machinal qui t’empêche de dormir, vraiment.